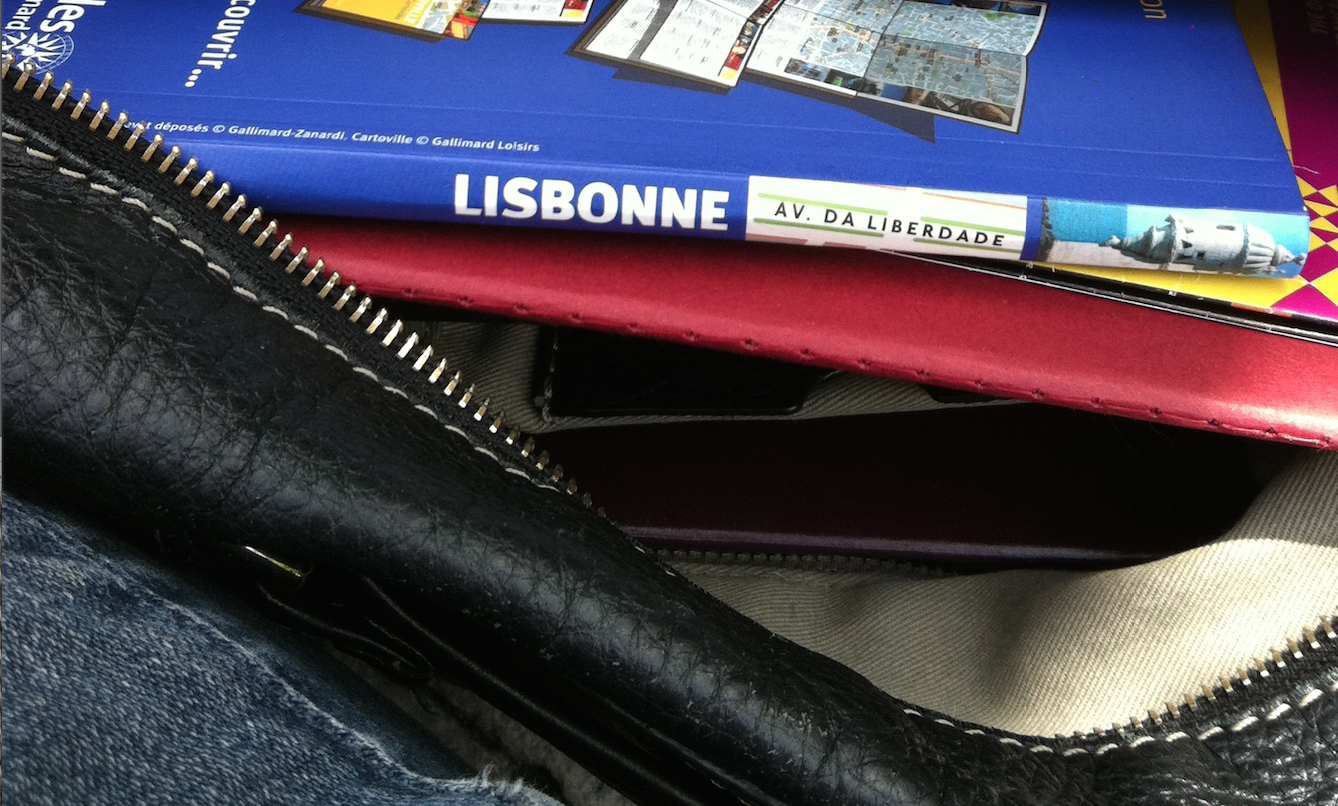Suivez ce nuage. Ne le laissez à aucun prix sans surveillance.
Oui, il semble inoffensif. Mais nous avons des ordres. Il y a déjà eu assez de problèmes, des dégâts considérables, voyez-vous, avec des nuages semblables à celui-là, et qu’on a laissé filer.
Ils apparaissent un matin de printemps, dans le ciel clair d’avril, au dessus des feuilles neuves des arbres du parc, et les passants ne peuvent s’empêcher de les suivre du regard. Le vent les pousse doucement, ils vont nul ne sait où, duveteux et blancs, l’air parfaitement innocent. Mais voyez comme ils sont, tissés de presque rien, dangereusement instables, beaucoup trop fragiles, comment compter sur eux ? Regardez celui-ci, regardez-le bien, puis détournez un instant le regard et observez-le ensuite à nouveau : il a changé de forme, vous voyez bien, le creux, là, est un peu plus creusé, non, vous ne trouvez pas ?
Allongés dans l’herbe, nous regardions – t’en souviens-tu petit frère ? – les gros nuages qui roulaient si souvent dans le ciel normand, d’énormes cumulus que le vent transformait en personnages ou en animaux, inquiétants de réalisme, à la fois proches et lointains, vrais et faux, présents et absents. Il m’était impossible de suivre la direction de ton doigt : là, non, là, tu ne vois pas ? Non, je ne voyais pas de grosse dame chantant les yeux fermés, et toi, pourquoi ne voyais-tu pas cet ours qui s’étirait ? Ce bébé joufflu ? Cette dame à chignon ? Ce nageur victorieux ? Non, je ne voyais pas ce type à grand nez, et toi, pourquoi ne voyais-tu pas le profil de l’aviatrice ? Le chat endormi ? Le nain Grincheux ?
Oui, oui, bien sûr, je veux bien suivre ce nuage. Je n’ai jamais dit que je ne le suivrai pas. Je vais m’efforcer d’obéir aux ordres. Mais serai-je certaine qu’il s’agit bien de celui que l’on m’a désigné ? Tandis que je boutonnais mon imperméable, il a déjà changé trois fois de forme, et s’est divisé, il y a deux nuages maintenant. Lequel choisir ?